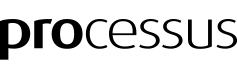INTERVIEW
- Premier contact avec la photographie ?
Bertrand Meunier : J'ai commencé la photo vers trente ans. Avant cela, je faisais totalement autre chose… Je me suis mis à beaucoup voyager, particulièrement en Chine, et ce pays est devenu une passion. Les voyages m'ont donné envie de prendre le temps de poser un vrai regard sur cette société, autre que celui d'un touriste ou d'un voyageur, ou même d'un voyageur photographe, de réellement observer, analyser l'évolution chinoise.
- Et durant près de dix ans, vous allez travailler sur ce projet, qui donnera Erased
BM : J'ai décidé de choisir, comme thématique et comme axe de travail, les grandes restructurations étatiques chinoises, ce que l'on a appellé les "Grandes Réformes" de Deng Xiaoping, que celui-ci a lancées à partir de 1998.
J'ai travaillé sur le nord-est chinois, le Dongbei, et le centre de la Chine, là où les villes, qui faisaient la gloire du monde ouvrier sous Mao, devinrent, avec les réformes, des zones de non-droit, des zones vides, des zones de chômage, annonçant la fin du monde ouvrier étatique. Sous Mao, l'ouvrier chinois était en haut de la pyramide, il bénéficiait du plein emploi, d'un logement, de la sécurité sociale, de l'école pour ses enfants. En l'espace de quelques années seulement, cette catégorie sociale a tout perdu et j'ai voulu questionner ces changements-là.
- Vous vous défendez cependant d'être photo-journaliste
BM : Je ne suis pas journaliste, non, je ne travaille pas sur l'événement, ni sur l'actualité. Il n'y a pas d'information dans ma photo. L'information est même plutôt à l'extérieur du cadre. Je ne suis pas là pour affirmer quoi que ce soit, aucune vérité. Mes images sont subjectives. Je revendique plutôt une déambulation de documentariste, autour du fondement même de la photographie, ce qu'elle veut dire, et pourquoi faire des images. C'est précisément cet angle-là que je trouve passionnant.
- Outre le prix Leica Oskar-Barnack en 2001 et le prix Niépce en 2007, entre 2005 et 2009, le Fonds National d’Art Contemporain va acquérir des oeuvres de la série Erased, ainsi que la Bibliothèque Nationale de France et le Musée de la photographie de Chalon-sur-Saône. En 2005, paraissait Sang de la Chine, en collaboration avec le journaliste Pierre Haski, ouvrage qui recevra le prix international des Médias et prix Joseph Kessel. Une reconnaissance qui vous a aidé à poursuivre vos projets personnels
BM :
Erased ne répondait, en effet, à aucune commande de magazine. C'était une initiative entièrement personnelle, que je devais donc mener avec mes propres moyens et, de temps en temps, j'acceptais quelques travaux pour la presse. J'ai collaboré avec
Libération ou
Newsweek, autour d'un tout autre axe de travail, mais qui me permettait néanmoins de poursuivre mon questionnement sur ce qu'est la photographie. À
Libé, j'ai beaucoup travaillé avec Pierre Haski, journaliste basé à Pékin et avec lequel je m'entends très bien, autant humainement que dans la façon d'aborder un sujet journalistique. Par ailleurs, travailler pour
Newsweek (journal américain) nous permettait de rester, pour nous photographes, à la fois indépendant financièrement, et indépendant dans notre façon d'aborder l'image. Notre mission de photographe n'était pas d'illustrer simplement l'article d'un journaliste - ce que l'on entend parfois en France - et ce qui constituait, du même coup, une différence d'approche photographique majeure entre les américains et nous. Il était étonnant de voir, à l'époque, l'incroyable liberté qu'un magazine aussi reconnu que
Newsweek pouvait accorder aux photographes. De belles expériences… Mais la base de mon travail demeurait mon travail personnel.
- La Chine a exercé sur vous une véritable fascination. Mais vous avez également abordé d'autres sujets ?
BM : La Chine m'a pris beaucoup de temps, en effet. Pour changer d'air, j'ai travaillé un temps sur le Pakistan et l'Afghanistan. Et puis, depuis plus de cinq ans maintenant, j'ai abordé un travail personnel sur la France, que j'ai appelé
Je suis d'ici.
Après tous les voyages que j'ai pu faire à travers le monde, j'ai eu envie de m'interroger sur mon propre pays, sur la société française, et je me suis posé cette question : comment vit-on en France, actuellement ? J'ai décidé de faire des séries, que j'associe en tableaux, par thématique : la dégradation des biens sociaux de nos villes, les nouvelles zones pavillonnaires, l'explosion des centres commerciaux à l'extérieur des villes, la fermeture des magasins de proximité, la désertification des centres villes, etc.
Je pense notamment à Robert Adams ou Lewis Baltz, qui m'ont beaucoup inspiré. Ces questionnements, qu'ils ont eux-même abordés avec cinquante ans d'écart, peuvent être abordés de la même façon en 2016, je pense. J'ai beaucoup de respect et d'admiration aussi pour la photo américaine des années 70/80, et ce traitement topographique, analytique, sociologique et ethnologique de l'image. La photographie va souvent regarder l'extraordinaire, ce que j'appelle cette gymnastique de la photographie. Ce qui m'intéresse, pour ma part, c'est au contraire toute cette banalité que l'on traverse sans regarder, ce qu'Ed Rusha, dans
Twentysix Gazoline Stations appelait de la non-photo. Parce que banalité ne veut pas dire anecdotique. J'essaye de m'arrêter : prendre un petit hôtel Ibis, rester quelques jours sur une zone commerciale, y traîner, attendre. Une sorte de déambulation poétique. Je photographie les lieux, et je fais également des portraits des gens que je rencontre. Parce que justement, il y a bien des gens qui habitent-là, dans ces pavillons que l'on construit autour des centres commerciaux, ou carrément, même, à l'intérieur des centres commerciaux, parce que les terrains y sont moins chers. Ces choix politiques d'aménagement du territoire ont des répercutions extrêmement fortes sur la société et engendrent de nouveaux comportements sociaux.
Il y a de nombreux auteurs, urbanistes, sociologues, qui se penchent sur ces sujets et les aborder en photo me passionne. Travailler sur la manière de photographier ces murs, ces parkings. Et pour cela, je privilégie les formats petits, que l'on peut s'approprier, comme des sortes de documents. Je photographie souvent l'hiver, pour avoir cette lumière particulière, en argentique, en N&B. Une façon d'exploiter la matière argentique, le film, le grain, et de pousser la neutralité à l'extrême - si l'on peut dire.
- Vous travaillez uniquement en argentique ?
BM : Je n'utilise pas le numérique - je n'ai rien contre cependant - mais j'aime beaucoup la lenteur. En continuant à travailler en argentique, je me préserve de cette facilité à répondre trop rapidement à la commande. Il peut m'arriver de le faire, parfois, mais j'évite. Je suis assez déboussolé par cette façon de travailler : pas le temps de faire la photo qu'elle est déjà envoyée à l'impression au magazine. C'est un temps de fonctionnement qui ne me correspond pas. Je suis quelqu'un de lent. Mes films sont rangés dans mon sac et j'ai l'impression qu'en attendant, ils s'améliorent. Je découvre mes images sur la planche-contact, et pas avant. J'aime le papier argentique, le tirage sous l'agrandisseur, toujours forcement un peu différent à chaque reproduction, qu'on le veuille ou non. En numérique, l'image est reproductible à l'infini, à l'identique, et le rendu est parfait. Moi, j'aime l'imperfection.
La série sur la Chine
Erased a été réalisée uniquement en N&B, avec des films poussés à 1600, pour obtenir plus de grain, et rendre cette matière que je voulais que l'on ressente, celles des zones industrielles et des usines. En France, pour la série
Je suis d'ici, je suis à plutôt 200/260 ASA, toujours en N&B, avec un traitement très gris que je surexpose. Travailler en argentique est un choix de fonctionnement - qui ne vient pas ajouter quoi que ce soit à la qualité du travail d'ailleurs. Un petit plaisir personnel que je m'accorde.
- Quels sont les photographes qui vous ont donné envie de faire de la photo ?
BM : Mes influences viennent davantage du cinéma et du documentaire. Des plans-séquences d'Andreï Tarkowski ou d'Ingmar Bergman. Des films de Chris Marker, de Jia Zhangke tels que
Xiao Wu, Artisan pickpocket ou
Touch of sin. De documentaristes chinois, comme Wang Bing, Zhao Liang (avec
La cour des plaignants ou
Behemoth), ou russe comme Alexandre Sokourov. Tous ces auteurs - et il y en a beaucoup d'autres bien sûr ! - ont su poser une camera et filmer en laissant tourner, en se donnant le temps d'enregistrer quelque chose. À l'opposé de la rapidité actuelle, proposer cette lenteur : comme Wang Bing, avec
À l'Ouest des rails, qui signe un documentaire de neuf heures, produit et filmé par ses propres moyens, une grande fresque sur la fermeture des complexes industriels du nord-est de la Chine, ou Frederick Wiseman, avec
Public Housing, qui signe lui un documentaire de plus de trois heures, tourné dans une cité d'un ghetto noir de Chicago, conflits sociaux, drogue, chômage, etc. Ce sont des documentaristes qui m'ont donné envie, dans leur démarche et dans leur engagement ; qui font douter le spectateur et où rien, dans leur travail, n'est pré-écrit. En photo, j'aime beaucoup le travail de Lewis Baltz, Robert Adams, les premiers travaux d'Anders Petersen, d'Alex Mayoli, et plus récemment Valérie Jouve ou Martin Kollar. J'ai été également très marqué par le travail du magazine
Provoke : à la fin des années 60, dans les milieux artistiques et intellectuels, montaient des mouvements de contestation - pas seulement en France - et en 1968, est arrivé
Provoke, une revue avant-gardiste japonaise, autour de Yutaka Takanashi, Takuma Nakahira, Shomei Tomatsu, Daido Moriyama, avec cette idée de collectif, de collaboration entre photographes, philosophes, graphistes, etc. Une esthétique complètement décalée par rapport à l'identité japonaise de l'époque, encore très formelle, qui venait exploser tous les codes culturels de la société. Et au-delà même de l'aspect artistique, l'engagement politique était très fort à
Provoke ; un esprit et une liberté de réflexion que l'on a envie de retrouver à Tendance Floue.
- La photo, pour vous, c'est quoi ?
BM : L'image, pour moi, est un langage. On peut quasiment tous réussir de belles photos : mais après, qu'est-ce que l'on veut dire, avec ce talent ? Épater ? Faire vendre ? Pour moi la photographie n'est pas synonyme d'entertainment, et ne doit pas participer à toute cette chaîne consumériste, je pense à Guy Debord et aux situationnistes. La réflexion, l'analyse, la narration, dans les films documentaires, vont plutôt de soit. Ce qui est plus difficile, c'est de raconter quelque chose avec des images, ce que Robert Franck a réussi de façon extraordinaire. En photo, on aimait bien la belle image, l'image unique. Et puis soudain, Robert Franck, avec
Les Américains, a su intégrer une narration photographique, un parti-pris affirmé, sur des thématiques. Et ce travail-là m'a réellement impressionné, m'a donné envie de faire de l'image. Je ne conçois pas la photo unique. J'aime fonctionner par association pour construire une narration et poser des questions.
- En 2006, vous quittez l'agence VU' pour rejoindre le collectif Tendance Floue. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce projet ?
BM : L'idée de travailler tous ensemble pour arriver à une oeuvre collective. Et associer des peintres, associer des journalistes, des poètes, des écrivains, des graphistes, comme on pu le faire, par exemple, le groupe GRAPUS dans les années 70. L'enjeu n'est pas de se soutenir mutuellement face aux difficultés économiques que peut rencontrer le photographe - individuellement. Le collectif n'est pas là non plus pour mettre simplement nos images en archive et nous fournir un local. Il s'agit, pour nous tous, de faire oeuvre collective, dans la création, par la création. Cette notion de "collectif" n'est pas très valorisée dans nos sociétés. Au contraire, il s'agit plutôt de casser ces initiatives, de tendre vers quelque chose de plus individuel, et particulièrement chez les photographes. Combien reste-t-il de collectifs de photographes aujourd'hui ? Personne ne comprend ce qu'est une oeuvre collective, ce qu'est un collectif. Il faut mettre un nom sur une photo. On a du mal à faire accepter celui d'un collectif. À Tendance Floue, on ne signe pas nos photos, et cela dérange, mais cela fait aussi vingt cinq ans que l'on existe, et que l'on défend cette oeuvre collective. Malgré les difficultés financières, malgré nos engueulades, les sacrifices… On est autofinancés et on tient.
- Parlez-nous de cette oeuvre collective justement, par exemple de Made in China, Nomad in Beijing, paru en 2007 : comment est né ce projet hybride ?
BM : J'ai voulu embarquer les photographes de Tendance Floue travailler et se questionner tous ensemble sur Pékin, sur la Chine, en s'associant à d'autres artistes chinois, graphistes, écrivains, imprimeurs. Et le tout en quinze jours. Une performance !
Nous sommes partis là-bas, installés dans un hôtel, et aidés sur place à Pékin par des amis à moi. On faisait nos photos, en même temps, on recherchait un graphiste et des auteurs. On a travaillé tous ensemble sur une maquette, située entre le magazine et le livre, qui a donné
Made in China.
Ce projet, au départ, a été monté entièrement à nos frais. Publié à 1500 exemplaires, le livre est maintenant épuisé. L'expo qui a suivi a eu aussi du succès et nous a permis d'obtenir des aides, et par la suite, d'être invités - tous frais payés, cette fois - en Inde. Nous sommes donc tous repartis, sur le même concept, trois semaines. En 2008, nous avons renouvelé l'expérience en France, sur la Crise. Rétrospectivement, je trouve que c'est l'un des plus beaux de la série. On est d'abord partis dix-sept jours travailler chacun de son côté, et puis on est rentrés à Montreuil mettre ce travail en commun. On s'est associés à des intellectuels français, des auteurs, des graphistes, le tout imprimé par la CGT, avec des textes très forts. Parce que, justement, il n'y a pas que les photos du collectif, et c'est ce qui me passionne dans Tendance Floue, ce que j'essaye, coûte que coûte, de défendre. Certains ne comprennent pas et déplorent que cette mise en commun de la réflexion se fasse au détriment d'une certaine forme photographique - pas seulement axée sur l'individu. On reçoit pas mal de critiques, c'est loin d'être un engagement facile… Mais on fête nos 25 ans cette année !
- Dernier projet commun en date c'est KOREA On / Off ?
BM : Tendance Floue a fait partie des artistes invités sur le projet Année France-Corée 2015-2016, qui célèbre 130 ans de relations et d'échanges entre nos deux pays. La matière du projet est très riche : beaucoup de photos, du son, des films, des textes ; le projet sera exposé en septembre 2016, à Pusan, en Corée du Sud, dans un très beau musée qui a pris en charge tous les frais pour nous accueillir. En France, en revanche, c'est autre chose… On doit se débattre pour exposer ici, pour trouver un lieu adéquat prêt à recevoir douze travaux différents, des matières différentes, des manifestations artistiques différentes, vidéo, son, photo, de la typo, de la musique, etc. Chacun de nous traite le sujet à sa manière, au départ l'idée de dualité, autour notamment du drapeau coréen. Chacun a trouvé à s'exprimer sur cette idée de dualité - notion extrêmement ambiguë. Il s'agit maintenant de voir comment présenter notre travail en France.
- Des projets ?
BM : Je termine cette longue série sur la France,
Je suis d'ici et depuis deux ans environ, je travaille sur un projet photographique dans le 93, en collaboration avec un autre photographe de Tendance Floue, Alain Willaume. Un travail que l'on réalise à deux ; faire converger nos deux approches pour apréhender autrement cette question du territoire, et de l'espace. Je vais aussi sans doute travailler à nouveau sur la Chine. Faire le pendant, ou la suite d
'Erased, traiter tous ces changements qu'il y a eu depuis sept ou huit ans, les mutations économiques et sociales, l'essor immobilier, et l'économie liée à l'immobilier, etc. Il faut maintenant que je trouve des financements.
QUESTIONS SUBSIDIAIRES
- Quel (autre) métier auriez-vous aimé faire ?
BM : Ébéniste.
- Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire ?
BM : Aucun.
- Qu’est-ce qui vous fait réagir le plus de façon créative, spirituellement, ou émotionnellement ?
BM : Un sourire, la joie, mes enfants.
- Qu’est-ce qui, au contraire, vous met complètement à plat ?
BM : Notre époque.
- Quelle est votre drogue favorite ?
BM : La café.
- Quel bruit, quel son, aimez-vous entendre ?
BM : La neige tomber.
- Quel bruit détestez-vous ?
BM : Les klaxons.
- Quel est votre juron, gros mot, blasphème favori ?
BM : "Connard, abruti".
- Avez-vous un objet fétiche, un porte-bonheur ?
BM : Le chiffre 8, qui, dans la culture chinoise, est un nombre lié à la chance (et jamais le 4, qui lui, au contraire, est un chiffre porte-malheur).
- Quel don de la nature aimeriez-vous posséder ?
BM : Pouvoir voler.
- En quoi aimeriez-vous être réincarné ?
BM : En gibbon ou en paresseux.
- À quoi sert un photographe ?
BM : À poser des questions.
SI VOUS ÉTIEZ
- Une couleur ?
BM : Transparent.
- Une chanson ?
BM : Quelque chose de John Coltrane, ou de Thelonious Monk.
- Un objet ?
BM : Des chaussures de marche.
- Une œuvre d’art ?
BM : Un coucher de soleil sur l'Himalaya.
L'ARRÊT SUR IMAGE de Bertrand Meunier
Curauma est l’aboutissement de la résidence de création menée par Bertrand Meunier à Valparaiso en novembre 2013, à l’occasion du Festival International de Photographies de Valparaiso au Chili.
BM : En 2013, à l’occasion de la 4ème édition du FIFV, j'ai été invité en résidence à Valparaiso, capitale du Chili, pour un workshop auquel avait participé avant moi Antoine d'Agata, et après moi Anders Petersen. Valparaiso est une ville extraordinaire, classée par l'UNESCO, plantée face au Pacifique, bordée de collines… elle est hallucinante. L'économie chilienne est également, paraît-il, la meilleure d'Amérique latine, et pourtant, malgré tout, Valparaiso, cette ville légendaire, se dégrade petit à petit, principalement au niveau de l'habitat. Les classes moyennes quittent ce lieu magnifique pour faire construire des pavillons gris, de l'autre côté des collines - ce qu'ils appellent El Bosque. Ils détruisent la forêt et empruntent aux banques pour s'installer là, face aux murs en parpaing du pavillon d'à côté quasiment identique. Ce qui faisait la singularité de Valparaiso, principalement, c'était la vue unique de cette baie sur le Pacifique, et ses bâtisses colorées. À présent, pourtant, les gens déménagent, vont habiter face à un mur de brique et de béton, certains vendent, souvent à des promoteurs, qui transforment ces anciennes habitations typiques en duplex, en triplex qui seront ensuite loués à des touristes. C'est insensé ! D'un côté, c'est la ville ancienne, sublime, et le Pacifique. Pourtant, dès que les habitants ont un peu d'argent, ils partent habiter de l'autre côté.
J'aurais pu aller dans les bars pour réaliser ma série sur Valparaiso. C'est coloré, pittoresque. Mais j'ai préféré choisir cet angle, observer comment s'installe lentement cette déshumanisation de l'urbanisme, détruisant le paysage et l'habitat traditionnel au profit de la standardisation et de l'anonymat des grands ensembles. Et les organisateurs sur place m'ont dit qu'ils n'avaient jamais pensé à ce sujet, sans doute parce que ce phénomène peut sembler, au départ, presque banal, et qu'on le voit sans le voir.
Le collectif Tendance Floue fête cette année ses vingt cinq ans d'existence : vingt cinq ans de projets communs, de confrontation, d'assemblages, de combinaisons. Nous avons donc voulu demander à autre membre du collectif, le photographe Alain Willaume, de nous parler du projet commun sur lequel il travaille en ce moment, avec Bertrand Meunier.
Alain Willaume : Il y a un peu plus de deux ans, Bertrand m’a proposé de collaborer avec lui à un travail photographique dans le 93. Dès le départ, le principe est posé d’arpenter en binôme, au hasard et à pied, ce département que je connais peu.
J’aime cette idée de confronter le rythme paisible de la marche à un territoire a priori peu propice à ce type de déambulation. J’aime aussi ce défi de m’emparer d’un même sujet avec un autre photographe ; c’est l'un des plaisirs que nous partageons régulièrement à Tendance Floue. J’aime également être confronté aux risques que pose la représentation photographique d’un terrain aussi miné que celui des banlieues. Bertrand et moi sommes tous deux extrêmement conscients des pièges habituels de ce type de sujet, entre stigmatisation facile et angélisme béat.
Aborder ce travail avec lui m’a demandé de faire table rase de quelques certitudes. Dès lors que je m’associais avec lui, il me fallait inventer un vocabulaire spécifique. Pour la première fois, il fallait me démarquer expressément d’une pratique photographique donnée. Pas question pour moi, par exemple, de travailler en noir et blanc sur un sujet qui s’inscrit depuis de nombreuses années dans la démarche de Bertrand. Je me trouvai dans l’obligation d’inventer une voie nouvelle où la couleur, notamment, aurait sa part, même si je ne savais pas encore où cela me mènerait. C’est finalement sur le terrain, en tirant parti de l’étrange lumière d’une météo inhabituelle, que je pus ouvrir cette nouvelle voie et construire la fiction dont j’avais besoin pour, moi aussi, me sentir « chez moi » dans cette aventure.
Travailler à deux exige de prouver la pertinence d’un double regard et impose d’apporter une richesse et une complémentarité supplémentaires dans l’appréhension d’un même sujet. Il faut également qu’un tel dialogue s’insère naturellement dans nos propres démarches individuelles, sans compromis ni reniements. C’est là qu’entrent en lice nos deux expériences professionnelles, notre amitié et notre confiance réciproques, notre appartenance commune à Tendance Floue. Après tant de journées de marche et d’expériences partagées sur les routes d’un GR 93 qui n’appartient qu’à nous, cette alchimie humaine fonctionne toujours et l’addition de nos deux regards pose, me semble t-il, de nouvelles questions sur la représentation photographique des territoires péri-urbains.
Nous prévoyons de finir ce travail d’ici le printemps 2017.
UN PHOTOGRAPHE + UN LABO
Bertrand Meunier & Processus
- Pourquoi avez-vous choisi Processus ?
BM : Durant les premières années de ma carrière, je réalisais tout moi-même. Mais lorsque j'ai intégré Tendance Floue, le collectif travaillait déjà avec Processus. Et j'ai eu mon premier enfant à l'époque : j'ai demandé au labo d'agrandir, dans un 40x50, douze photos de la naissance de ma fille. Marie-Laure m'a offert le tirage, et cela m'a vraiment beaucoup touché. D'ailleurs, ce tirage est toujours chez moi...
Depuis, je continue à travailler avec eux.
Interview : Sandrine Fafet
(Mars 2016)